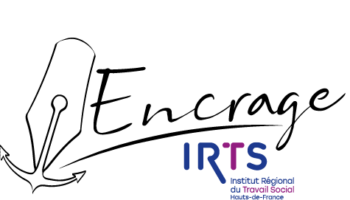Encrage : Valorisation des travaux des étudiants de l’IRTS Hauts-de-France
- Règlement de participation à la revue Encrage
- Fiche technique Revue Encrage
- Autorisation de diffusion
- Contact pour la revue Encrage : pole.recherche@irtshdf.fr
- ISSN : en cours
Encrage est une revue numérique qui a pour objectif de :
– Diffuser, capitaliser et transmettre un résumé « carte de visite » des travaux des apprenants IRTS aux professionnels et aux nouveaux apprenants
– Valoriser les travaux et les compétences des étudiants et créer de la visibilité
Le projet de publication concerne les travaux certifiés des étudiants de l’IRTS Hauts-de-France des niveaux 6 et 7 : ASS, ES, ETS, CESF, MF, CAFERUIS, DEIS et CAFDES : mémoire, dossier d’expertise, note d’aide à la décision, etc. L’appel à auteurs a été lancé auprès des promotions d’étudiants en cours de parcours.
Vous trouverez ci-après, en cliquant sur le titre, un court résumé des mémoires que des étudiants ont accepté de mettre en ligne.
Pour les étudiants de l’IRTS et les abonnés de l’Espace Santé Social, après identification, les documents en texte intégral sont accessibles sur le portail de l’Espace Santé Social. Un lien de connexion vous y mènera à la fin de chaque résumé.
Revue Encrage hors-série DEIS : août 2025
Encrage publie en septembre 2025 un Hors-Série consacré aux travaux d’ingénierie et de recherche appliquée des stagiaires diplômés du Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale DEIS.
Nos ingénieurs sociaux décryptent les vecteurs de réflexion dans leurs études pour une analyse dynamique en proposant un état des lieux vers de nouvelles pistes d’action.
Encrage est une revue numérique de l’IRTS Hauts-de-France, dans le cadre du PREFAS Hauts-de-France, financé par la DREETS Hauts-de-France.
Accédez à ce numéro hors-série de la revue Encrage
Revue Encrage n°3 : novembre 2024
Schizophrénie : l'autonomie dans le logement - COLSON Amandine
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Session 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « Schizophrénie : l'autonomie dans le logement »
Mots-clés : Schizophrénie, autonomie, logement, handicap psychique
Résumé :
La schizophrénie touche actuellement 1% de la population française, soit 600 000 personnes.
Ce handicap psychique implique des symptômes vécus différemment par les personnes qui en souffrent.
Si dans la réalité ces personnes souffrent de leur maladie, la schizophrénie est tellement marquée de stigmates que les personnes concernées se stigmatisent elles-mêmes.
Entre l'expression des symptômes, les éventuels effets secondaires du traitement et la stigmatisation qu'elles sont susceptibles de vivre, ces personnes peuvent être amenées à perdre de leur autonomie. L'OMS la classe d'ailleurs permis les 10 maladies les plus invalidantes.
Ces éléments peuvent fragiliser leur accès et leur maintien dans le logement. Pourtant, le maintien dans le logement est un des facteurs contribuant au rétablissement des personnes souffrant de schizophrénie.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=83&record=19424561124912427439
Aller vers et numérique, à la rencontre du pouvoir d’agir des publics marginalisés et des professionnels en prévention spécialisée - DEQUESNE Julian
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Session 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « Aller vers et numérique, à la rencontre du pouvoir d’agir des publics marginalisés et des professionnels en prévention spécialisée »
| Mots-clés : Numérique, aller vers, pouvoir d’agir, mineurs marginalisés, parentalité, éducation populaire |
Résumé :
Il n’est pas aisé de définir le numérique et son usage, autant par les
professionnels et les publics que par les pouvoirs publics et les institutions.
Ce travail prend racine par un constat tiré d'un territoire de prévention spécialisée : de
moins en moins de jeunes occupent l’espace publique mais restent chez eux, à investir le
monde numérique, plus vaste, plus attractif et moins réel. Que se passerait-il alors si les professionnels du travail social l’investissaient également ?
C’est par ce besoin identifié de retour au réel que va se cristalliser l’essence même de
l’éducation spécialisée : la réflexion, l’adaptation, le soutien et la juste proximité avec
les personnes.
La notion du numérique dans le travail social doit donc composer avec les jeunes, les
parents et les professionnels. C’est par la fameuse notion de pouvoir d’agir que réside
une capacité d’action et de co-construction à aller chercher avec les personnes, des
idées, des réponses et des actions. C’est cependant par l’aller vers sous toutes ses formes et son ouverture à se réinventer que réside la création de lien par le numérique, point d’entrée à une relation éducative numérique.
C’est avec ces valeurs professionnelles de vivre ensemble et d’éducation populaire,
concrètes et réelles, que le numérique peut donc être mieux compris, mieux pratiqué et
mieux cadré.
Ce mémoire de pratique professionnelle se retrouve donc à la croisée d’une posture, d’un positionnement et d’une identité professionnelle renforcée durant les trois années de formation au métier d’éducateur spécialisé.
Entrons alors dans ce travail de recherche amorcé il y a plus d’un an avec
intérêt pour la pratique de l’éduction spécialisée dans toutes les dimensions que cela implique.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=10&record=19426378124912445509
L’accompagnement d’enfants et d’adolescents avec troubles du spectre autistique : quelle place pour les parents ? - DUFLOT Angélique
Diplôme d’Educateur Spécialisé
Session 2023
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « L’accompagnement d’enfants et d’adolescents avec troubles du spectre autistique : quelle place pour les parents ? »
| Mots-clés : Autisme, parentalité, accompagnement, soutien |
Résumé :
Un proverbe africain dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Lorsque cet
enfant présente des difficultés comme des troubles du spectre autistique, le village
tout entier devient alors une ressource indispensable.
Les politiques d’action sociales et médico-sociales ont pour objectif depuis plus de
vingt ans maintenant de placer la personne accompagnée et sa famille au cœur de
tous les projets qui la concernent. Afin de mieux respecter les attentes et libres choix
de la personne, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
cherche à favoriser la participation des personnes accompagnées et/ou de ses
représentants légaux. Mais qu’en est-il réellement ?
Travaillant actuellement dans un Institut Médico-Educatif accompagnant des enfants
et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique, je me suis énormément
questionnée sur les répercussions de l’autisme sur l’environnement familial.
J’ai débuté ce mémoire de pratique professionnelle en me demandant en quoi les
pratiques éducatives pouvaient être un support dans l’accompagnement d’enfants et
d’adolescents porteurs de troubles du spectre autistique.
Tout au long de mon travail, ma réflexion a évolué, s’appuyant sur des apports
théoriques et pratiques, sur des entretiens menés auprès de travailleurs sociaux mais
aussi de mères d’enfants porteurs de troubles du spectre autistique.
Finalement, j’ai pu déconstruire entièrement mon travail pour l’orienter sur une toute
autre question : quelle place doit-on accorder au soutien à la parentalité dans le cadre
de l’accompagnement d’enfants et d’adolescents porteurs de troubles du spectre
autistique.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=86&record=19410313124912385959
La qualité de vie des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) au prisme des retentissements et représentations sociales du cancer - HARMANT Pauline
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social Session Juin 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « La qualité de vie des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) au prisme des retentissements et représentations sociales du cancer »
Mots-clés : Adolescence, jeunesse, cancer, QdV, société
Résumé :
Ce travail de recherche explore les différentes façons dont le cancer impacte la vie
quotidienne, ainsi que les difficultés et perspectives spécifiques aux publics adolescents et
jeunes adultes. Il étudie les retentissements sociaux de la maladie, tels qu’ils sont vécus par
les patients et perçus par les professionnels, du fait de leur expertise. Il étudie également
comment les représentations sociales du cancer dans la société influencent le regard des AJA sur la maladie, dès la consultation d’annonce. S’il appréhende les difficultés auxquelles les AJA sont confrontés lorsqu'ils souffrent d’un cancer, il étudie également les ressources
existantes, afin d’y répondre. Enfin, l’objectif de ce Mémoire est de mieux comprendre les
besoins des AJA pris en charge en oncologie dans le but d’améliorer leur qualité de vie
durant le parcours de soins.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=80&record=19424723124912429059
La culture mahoraise face à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap : se construire un avenir entre barrières et espoir - MADI MROUDJAE Mouliati
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Session 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « La culture mahoraise face à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap : se construire un avenir entre barrières et espoir »
| Mots-clés : Handicap, Culture, Insertion sociale, Insertion Professionnelle, Accompagnement, Inégalité, Acceptation Sociale |
Résumé :
Au fil du temps, le regard et l’acceptation du handicap ont largement évolué pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Dans certains territoires encore aujourd’hui, le handicap est perçu de manière singulière, mêlant croyances culturelles, spirituelles, animisme, tabous sociaux et enjeux institutionnels. A Mayotte, un département français, ce phénomène est d’autant plus perceptible que sur le reste du territoire. Malgré la mise en place des législations et des évolutions de la prise en charge du handicap, ce territoire est imprégné de croyances culturelles qui peuvent impacter la vie quotidienne des mahorais, notamment celle des personnes en situation de handicap et plusieurs freins persistent encore.
A travers cette problématique, j’ai formulé la question de départ suivante : Quelle influence la culture mahoraise peut avoir sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ? Dans mon approche théorique, plusieurs auteurs de différentes disciplines évoquent les difficultés auxquelles font face les personnes en situation de handicap ainsi que les spécificités culturelles qui peuvent exister et des évolutions sur cette thématique. En complément de l’approche conceptuelle, le travail de terrain mené auprès de diverses personnes (public concerné, professionnelles et des natifs du territoire) fait aussi apparaitre des analyses et des spécificités du territoire face au handicap. Dans ce travail, à travers l’hypothèse retenue, l’Assistante de Service Social peut entreprendre un travail pour favoriser une évolution culturelle et proposer des mesures concrètes pour promouvoir l’acceptation, l’inclusion sociale et ainsi réduire les inégalités pour les personnes en situation de handicap dans ce contexte particulier.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=32&record=19424727124912429099
Violences conjugales : Libérer les mots pour panser les maux - PAU Sophia
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Session 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « Violences conjugales : Libérer les mots pour panser les maux »
| Mots-clés : Violences conjugales. Emprise. Temporalité. |
Résumé :
En France, les violences conjugales faites aux femmes sont au cœur des politiques publiques. Bien que les politiques sociales évoluent autour de cette thématique, de nombreuses représentations persistent au sein de la société, favorisant une méconnaissance de ce que vivent les femmes victimes de violences conjugales.
Comment comprendre la mise en place des violences dans le couple et comment comprendre ce qui maintient ces femmes au sein de leur domicile conjugal ?
C’est en partie à ces questions que ce mémoire d’initiation à la recherche tente de répondre. J’ai d’abord fait un travail de compréhension autour du phénomène des violences conjugales, et, tenté, de mettre en lumière la réalité vécue par ces femmes, tout en faisant du lien avec le rôle de l’Assistante de Service Social dans l’accompagnement. Pour cela, j’ai travaillé autour de l’origine des violences conjugales, les notions de conflits et de violences, les différentes formes de violences conjugales, le cycle des violences, l’emprise, le cadre législatif et enfin, la notion de domicile conjugal.
Dans l’objectif de compléter mes recherches théoriques, des entretiens avec des professionnels confrontés à cette thématique et avec des femmes victimes de violences conjugales ont été effectués. Ces entretiens ont été une plus-value, me permettant d’alimenter ma réflexion et d’enrichir mon travail.
Lien vers le mémoire :
Violences conjugales : libérer les mots pour panser les maux (espacesantesocialhdf.fr)
Mal être au travail des pères salariés : une parentalité préservée ? - UGILLE Virginie
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Session 2024
ES / ASS / ETS / CESF : mémoire de pratique professionnelle
Titre : « Mal être au travail des pères salariés : une parentalité préservée ? »
| Mots-clés : Burnout considération, conscientisation, prévention |
Résumé :
Ce mémoire explore la relation entre les risques psychosociaux (RPS) chez les pères
salariés et leurs compétences psychosociales qui préservent la parentalité. Comment les
pères qui sont exposés aux RPS peuvent-ils préserver leur bien-être mental et émotionnel
tout en équilibrant leurs responsabilités professionnelles et familiales ?
À travers une analyse approfondie, ce travail de recherche examine comment une prise
de conscience accrue des RPS chez les pères salariés permet d'identifier et de prévenir
ces risques. Le mémoire aborde la capacité des pères à gérer les pressions professionnelles et les défis de la parentalité. En comprenant mieux les dynamiques entre les risques psychosociaux et la parentalité, ce travail propose des moyens concrets pour aider les pères à naviguer avec succès entre leur vie professionnelle et familiale.
Lien vers le mémoire :
https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=35&record=19424737124912429199
Revue Encrage n°2 : décembre 2023
Parcours de rue et parentalité : quelles incidences pour un Sans Domicile Fixe ? - Agathe BEAUVOIS
DEASS 2020/2023
Titre :
Parcours de rue et parentalité : quelles incidences pour un Sans Domicile Fixe ?
Mots-clés : Parentalité ; accès aux droits ; Sans Domicile Fixe ; enfant ; enceinte ; parcours de rue ; ruptures de parcours ; accompagnement ; besoin.
Résumé :
Quelles conséquences sur l’exercice de sa parentalité et sur l’accès aux droits pour une personne qui se trouve sans domicile fixe ? Cette question est le fil rouge de ce travail de mémoire de pratique professionnelle. Comment la personne sans domicile fixe exerce-t-elle sa parentalité dans la rue avec un enfant et/ou en étant enceinte ? Comment accède-t-elle aux droits liés à son enfant ? La parentalité est-elle un droit ?
Il existe un certain nombre de sans domicile fixe dans les rues, mais parmi eux se trouvent des familles, dont des mères, pères avec enfant(s). La recherche présentée dans ce mémoire questionne l’exercice de la parentalité alors que la rue peut bouleverser la vie d’une personne et de son enfant. Pour les personnes à la rue, quelles sont leurs priorités ? C’est ici toute la complexité de ce sujet.
Cette recherche s’appuie sur des éléments issus d’ouvrages théoriques et sur les témoignages de personnes concernées tels que des parents sans domicile fixe ayant vécu un parcours de rue avec un enfant et/ou enceinte. Les entretiens montrent que les parcours des personnes sont tous différents, selon l’itinéraire de la famille, de leur propre personnalité et des ruptures de chacun. Après avoir interrogé les représentations de départ et en reconstruit de nouvelles grâce à la qualité des explorations théoriques et pratiques, les travaux interrogent la question de recherche suivante : Comment travailler la parentalité d’une personne sans domicile fixe lorsque celle-ci n’a pas accès à ses propres besoins ? Au-delà de ces questionnements, ce mémoire m’a permis de continuer d’interroger l’éthique et la déontologie de l’Assistante de Service Sociale.
Les femmes bénéficiaires du RSA sur le territoire de Douchy-les-Mines et leur insertion professionnelle. "Travailler ? Oui, mais moi j'peux pas maintenant" - Emma DESMET
DEASS 2020/2023
Titre :
Les femmes bénéficiaires du RSA sur le territoire de Douchy-les-Mines et leur insertion professionnelle. "Travailler ? Oui, mais moi j'peux pas maintenant"
Mots-clés : Femme - mère - héritage - socioculturel - acteur - RSA - insertion professionnelle - contexte socioéconomique - territoire.
Résumé :
Le RSA a été mis en place en 2009. Il s'adresse aux personnes n'ayant pas d'emploi et ne bénéficiant pas d'une indemnisation chômage. Il offre aux personnes allocataires un accompagnement dont l'objectif final est le retour à l'emploi.
Je me demande ce qui intervient dans l'accès à l'emploi des femmes, pourquoi sont-elles plus nombreuses ? Est-ce plus difficile ? Quelle est l'influence du territoire ? Quelles sont les conséquences du RSA sur les bénéficiaires ?
Pour répondre à ma question de départ "En quoi l'héritage socioculturel de la femme au foyer bénéficiaire du RSA habitant Douchy-les-Mines, impacte son insertion professionnelle ?", je mobilise les concepts "déterminisme", "héritage socioculturel" de Pierre Bourdieu et "d'acteur" de Bernard Lahire et me réfère aux données socioéconomiques et historiques du territoire et les politiques publiques RSA. Je les croise avec les données empiriques recueillies lors d'entretiens semi-directifs menés auprès des femmes bénéficiaires du RSA sur le territoire concerné.
J'étudie la situation singulière des femmes face à l'insertion professionnelle et au regard des politiques publiques de l'emploi. Je comprends que les femmes sont héritières d'un modèle traditionnel, celui de la femme et surtout de mère au foyer. Elles en ont conscience et veulent s'émanciper par le travail à certaines conditions et au moment de leur choix.
Ces éléments d'enquête me permettent d'ajuster mon accompagnement en prenant en compte leurs spécificités et désirs. Mon travail d'ASS est de personnaliser les politiques publiques qui se veulent généralistes.
Considérer la culture des mineurs non accompagnés : la clé d’un parcours d’intégration réussi ? - Marc-Antoine DE SEZE
DEES 2020/2023
Titre :
Considérer la culture des mineurs non accompagnés : la clé d’un parcours d’intégration réussi ?
Mots-Clés :
MNA, culture, identité, accueil, intégration
Résumé :
L’accompagnement de Mineurs Non Accompagnés dans un établissement d’hébergement en diffus m’a amené à des questionnements. Sur la considération portée à la culture de ces jeunes étrangers, sur l’influence de cette considération dans leur parcours d’intégration. Ces questionnements résonnent davantage encore ces derniers mois, alors que la question des migrants et de leur accueil occupe un temps d’antenne considérable dans les médias.
Cette crise de l’accueil est un phénomène réel et observable au quotidien, dans les établissements sociaux qui ont pour mission d’accompagner et justement d’accueillir ces publics “migrants”. Pour les MNA, leur nombre est en hausse constante depuis des années, et il arrive fréquemment que les sites de mise à l’abri soient saturés et en tension. Le Nord, bien qu’il ne diffère pas d’une tendance nationale, est particulièrement touché par ce phénomène.
La partie exploratoire de ce travail est divisé autour de 3 notions majeures : la notion de Mineur Non Accompagné, l’Identité et l’Intégration. Le terme MNA est récent, la problématique des jeunes exilés est un sujet de politique sociale considéré depuis la Convention Internationale des Droits de l’Enfance en 1989. L’accueil et la prise en charge de ces jeunes se fait en France à l’ASE, la plupart du temps dans des établissements spécialisés comme les DAHMNA qui n’accueillent que des jeunes étrangers. Il n’existe en revanche pas de cadre législatif particulier aux MNA.
Les conditions de placement de ces jeunes sont particulières : le mode d’hébergement diffus en “semi autonomie”, disposant de financements très réduits (bien inférieurs à la moyenne de l’ASE), pose les problèmes d’une présence éducative réduite et de défaillance des logements qui eux-mêmes posent la question de l’impact de ce mode d’hébergement sur la construction d’un adolescent déjà marqué par un parcours extrêmement violent. La construction identitaire de ces jeunes est en effet particulière. L’identification au statut de MNA, voire à la notion d’adolescence, dépend de leur origine sociale et de leur parcours de vie et de migration. La temporalité, les conditions de placement, l’ethnie et la nationalité, les langues parlées sont autant de facteurs influant sur la construction identitaire de ces jeunes déracinés. La place de l’éducateur est aussi particulière car ces jeunes n’ont pas de parents sur le territoire. L’éducateur devient la figure de référence du jeune. L’enjeu majeur de l’accompagnement de ces jeunes est leur réussite dans un parcours d’intégration semé d’obstacles : touchés par un choc culturel, ils doivent socialiser sur le territoire et préparer la majorité dès leur arrivée tout en répondant à l’injonction de se professionnaliser et en subissant toutes sortes de discriminations. Le travailleur social, par l’adaptation de sa posture aux spécificités de ce public, peut être d’une grande aide, les deux clés seraient l’acceptation du rôle de figure d’attachement et la curiosité culturelle.
Les parents face au trouble du spectre de l'autisme de leur enfant - Camille FONTAINE
DEASS 2020/2023
Titre : Les parents face au trouble du spectre de l'autisme de leur enfant
Mots-clés : Accompagnement, diagnostic, enfant, handicap, isolement, parent, parent aidant, partenariat, trouble du spectre de l’autisme.
Résumé :
Depuis plusieurs années, l’autisme est de plus en plus reconnu en France, à travers les médias ou encore dans les politiques sociales qui prônent la notion d’inclusion.
Toutefois, la place des parents dont un enfant souffre de trouble du spectre de l’autisme est plus rarement abordée.
Ce travail de recherche vise à comprendre le parcours des parents : des premiers signes d’inquiétude, en passant par l‘annonce du diagnostic, jusqu’à la compréhension et l’acceptation de celui-ci.
En cherchant à comprendre le parcours des parents avec un enfant souffrant de trouble du spectre de l’autisme, ce travail de recherche vise à mettre en lumière un public peu représenté, à travers ses ressources et ses difficultés, pour permettre aux assistants de service sociaux d’adapter leur pratique professionnelle.
Être parent d’enfant en situation de Handicap : le difficile chemin vers l’acceptation - Moinamaoulida MCHINDRA
DEASS 2020/2023
Titre : « Être parent d’enfant en situation de Handicap : le difficile chemin vers l’acceptation »
Mots-clés : Handicap, acceptation, parent, enfant, Mayotte, représentation, société, croyance, pratique, culture d’inclusion, inclusion, prévention, sensibilisation
Résumé :
| L’acceptation du handicap d’un enfant n’est pas toujours quelque chose de simple. Encore plus sur un territoire comme Mayotte où la représentation de la personne en situation de handicap et du handicap est influencée par des croyances. 101ème département français, Mayotte est une petite île se situant dans l'Océan Indien. Cette île de 374 km², abrite différentes cultures et traditions toujours profondément ancrées à ce jour, même après sa départementalisation. Par conséquent, la vision et la définition du handicap diffèrent de l’Hexagone.
J’ai souhaité dans le cadre de ce mémoire comprendre ces représentations, ainsi que l’impact que cela avait sur les parents d’avoir un enfant dit différent. De par cette recherche, je me suis questionnée sur la pratique professionnelle de l’Assistante de Service Social dans le cadre du phénomène. Comment l’Assistant de service social pourrait accompagner ces parents vers ce processus d’acceptation tout en prenant en compte l’environnement culturel du territoire ? Quels peuvent être les outils existant et mis en place par les institutions ? Quelle peut être l'approche qu’ont les parents envers le handicap de leur enfant ? Les apports théoriques et pratiques viennent soulever d’autres problématiques dans le cadre de la reconnaissance ou la méconnaissance du handicap par les parents, influencées par divers facteurs tels que la prise en charge après l’annonce du handicap ou encore la barrière de la langue.
Ce travail de recherche vient déconstruire toutes les représentations autour du sujet pour soulever d’autres réflexions, pouvant faire évoluer les pratiques professionnelles de l’Assistant de Service Social. |
Pour consulter le document intégral (attention, veillez à être connecté à Espace Santé Social) : cliquez ici
La personne sans abri et son animal de compagnie : Le chien, c’est dehors - Agathe SERRANO
DEASS 2020/2023
Titre : La personne sans abri et son animal de compagnie : Le chien, c’est dehors.
Mots-clés : sans abri, SDF, Marginalisation, chien, parcours d’insertion.
Résumé :
Le travail de recherche présenté porte sur le parcours d’insertion des personnes sans-abri qui possèdent un ou plusieurs chiens.
Evoluant au fil des années, les personnes sans abri ont toujours existé. Les parcours d’insertion, les modes de vie ainsi que les parcours de rue de ces personnes sont complexes et propres à chacune. Alors que l’accès qu’il soit au sein d’un hébergement, d’un logement, concernant la santé, ou bien lors des démarches administratives, est de plus en plus difficile pour ces personnes. Je me rends rapidement compte que la possession d’un animal de compagnie notamment un chien apparaît le plus souvent comme un frein supplémentaire dans le parcours d’insertion de ces personnes.
Ce mémoire de pratique professionnelle s’articule autour du questionnement suivant :
« En quoi l’animal de compagnie de la personne sans abri peut-il influencer son parcours d’insertion ? »
Cette dernière m’a permis de m’orienter vers la théorie qui est nécessaire à la compréhension de ce sujet et m’a donné l’opportunité de rencontrer les personnes sans abri et les professionnels concernés.
Suite à ces explorations, de nouveaux questionnements sont venus m’apporter un nouvel axe à mon mémoire de pratique professionnelle, m’amenant à formuler ma question de recherche :
« En quoi la présence du chien influe-t-elle sur la marginalisation de la personne sans abri ? »
Pour consulter le document intégral (attention, veillez à être connecté à Espace Santé Social) : cliquez ici
Revue Encrage n°1 : février 2023
La place de la personne polyhandicapée dans la société - AMOUZOU Koffitse Mawuénam
DEES 2022
Titre :
La place de la personne polyhandicapée dans la société
Mots-Clés :
Liberté de choix ; citoyenneté ; autodétermination ; empowerment ; valorisation des rôles sociaux ; polyhandicap
Résumé :
La complexité de la situation de handicap des personnes polyhandicapées est liée à plusieurs facteurs qui entrainent une importante dépendance, ainsi elles sont limitées et manquent d’autonomie de décision et de participation dans leur quotidien.
L’équipe pluridisciplinaire est alors invitée à observer, à repérer, à se questionner, à travailler en équipe, à impliquer la personne concernée afin de répondre au mieux aux demandes et être un agent causal/médiateur/facilitateur dans le quotidien. Tout cela dans l’objectif d’accompagner à développer les compétences, à pousser leurs limites et difficultés dans la mesure du possible, pour favoriser leur épanouissement personnel et leur donner accès à une qualité de vie satisfaisante. Est-ce que c’est bien cela qu’il veut ?
Est-ce que c’est ce genre de musique qu’elle aime ? Ou encore est-ce ce vêtement qu’il aimerait porter aujourd’hui ? Qu’est-ce qui le passionne ?
Comment puis-je les faire participer ?... Voilà quelques questions qui ont déterminé mon accompagnement durant mes trois ans d’apprentissage à la Maison d’Accueil Spécialisé et qui ont suscité en moi d’autres questions auxquelles j’ai essayé de répondre dans mon mémoire de pratique professionnelle.
Si nous leur faisons confiance et leur donnons l’occasion, ils sont prêts à se dévoiler et à nous surprendre.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=120&record=19411418124912396909
L'avancée en âge des personnes en situation de handicap : un défi managérial - GROUZELLE Émilie
CAFERUIS 2020
Titre :
L'avancée en âge des personnes en situation de handicap : un défi managérial
Mots-clés :
Accompagnement, changement, équipe
Résumé :
Je fais fonction de cadre intermédiaire dans un établissement médico-social accueillant des adultes en situation de handicap intellectuel et psychique. Je constate que les réponses apportées par les professionnels aux besoins individualisés des personnes en situation de handicaps vieillissantes ne sont pas satisfaisantes. La stratégie prise par la direction pour l’établissement est de transformer une unité de vie en une unité de vie pour personne en situation de handicap vieillissante (UVPHV).
Le vieillissement de la personne accompagnée n’ayant pas été anticipé au sein de la structure, les professionnels se retrouvent en difficultés pour adapter leurs pratiques aux besoins de la personne.
Au travers d’un diagnostic, j’ai émis plusieurs hypothèses permettant d’avoir des éléments de compréhensions et d’explications. Leurs vérifications ont mis en exergues plusieurs facteurs qui légitiment la crainte des équipes à faire évoluer leurs pratiques professionnelles : le sens, la culture, les compétences et le changement.
Manager un projet de transformation d’activité, c’est manager des incertitudes. Le cadre intermédiaire que je suis doit faciliter le changement en mettant en place les conditions nécessaires à la compréhension du projet et l’acceptation de celui-ci.
La co-construction du projet d’établissement permet de fédérer les professionnels autour de valeurs, missions et d’objectifs commun, tant dans une dimension éthique qu’opérationnelle. Il définit le cadre qui donne sens et organise l’activité professionnelle. En amont de cette étape détaillée dans un plan d’action, il me paraissait incontournable de rétablir le sens de cette commande et de mettre en place des dispositifs de soutiens aux professionnels au travers le développement des compétences individuelles et collectives. Ces préconisations ont pour objectif d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes accompagnées.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=1&record=19413940124912311229
Et, l'amour dans tout ça ? HERVIEU Elise
DEES 2022
Titre :
Et, l'amour dans tout ça ?
Mots-Clés :
Posture professionnelle - relation éducative - engagement - amour - distance
Résumé :
Septembre 2019 ; je plante mon jardin intérieur en terre étrangère : l’Institut Régional du Travail Social. Au rythme lent de la germination des premières pousses, des premières réflexions, je prends conscience de la complexité du métier d’éducateur spécialisé.
Dès le début ma formation, j’ai pu entendre à plusieurs reprises la notion de « bonne distance » via les intervenants, mais sans réellement y mettre une définition commune. L’émetteur m’envoie une information que je n’arrive pas à réceptionner ; c’est dans ce questionnement que le sujet émerge. Et pour cause, il y a une envie d’aller en quête de réponses. Mon questionnement principal était : « Pourquoi parlons-nous de bonne distance et non de juste proximité, voire d’amour dans la relation éducative ? »
Une exploration engagée fait jour, la sérendipité apparait ; de nouvelles notions se manifestent. Au vu des entretiens avec Philippe Gaberan et Guy Hardy, un champ lexical jaillit autour de l’amour ; dimension affective, amour compassionnel, point d’affection… À la résonance de ces propos, les avis divergent. Pouvons-nous parler d’amour dans la relation éducative ? Ce mot qui a lui seul produit un malaise et une gêne. Ce sujet est peu mis en avant mais semble être l’origine de nombreuses interrogations pour l’éducateur spécialisé. Faut-il oser déconstruire certaines de nos pratiques professionnelles pour les reconstruire ?
Une narration qui donne visibilité à un sujet tabou et qui apporte une singularité en raison d’une intrigue permanente au regard des différents apprentissages. Une nouveauté inattendue qui permet de reproblématiser afin de répondre à l’objectif du mémoire ; formuler une problématique éducative.
Lors de l’écriture de ce mémoire de pratique professionnelle, je n’ai jamais essayé de romancer les combats - j’espère simplement qu’un jour, nous pourrons exprimer ouvertement les hauteurs de notre cœur, sans honte et tabou. Mais parce que nous n’avons pas atteint ce niveau de confort, je ne peux vous mentir : j’aime voir nos masques d’évitement émotionnel glisser lorsque nous nous battons et réalisons diverses recherches sur le sujet.
En définitif, cet écrit m’a permis d’évoquer un sujet qui me questionnait énormément ; la place de l’amour dans la relation éducative. J’ai pu faire la rencontre de certains professionnels qui osent s’exprimer ouvertement sur les profondeurs de ce sujet, sans gêne parce qu’ils sont convaincus de l’importance de la dimension affective. Ils prônent ces joyeux de proximité émotionnelle qui se rejouent souvent tous les jours, à des moments précis du quotidien.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=112&record=19408325124912265079
« Moi, la retraite j’y vais pas ! » ou Le départ à la retraite des travailleurs handicapés en ESAT - HOBERG Julie
DEASS 2012
Titre :
« Moi, la retraite j’y vais pas ! » ou Le départ à la retraite des travailleurs handicapés en ESAT
Mots-clés :
Retraite, ESAT, Handicap
Résumé :
Aujourd’hui, l’allongement de la durée de vie est un phénomène de société qui concerne également les personnes en situation de handicap. D’après les recherches de la Fondation John Bost, l’espérance de vie de ces personnes serait passée de 48 ans à 60 ans entre les périodes de 1972-1979 et 1980-1990. Cette nouvelle longévité s’explique à la fois par les progrès médicaux, par l’amélioration des conditions de vie et de la prise en charge médico-sociale de la population handicapée.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=1&record=19412478124912306509
L'inceste adelphique - MAS Lisa
DEES 2022
Titre :
L'inceste adelphique
Mots-clés :
inceste ; accompagnement ; violences ; reconstruction ; fraternel
Résumé :
Le 7 janvier 2021, le livre de Camille Kouchner « La Familia grande » est publiée aux éditons Joël Saget. L’auteur y relate l’histoire de son frère, victime de viol par leur beau-père, Olivier Duhamel. De ce fait, l’inceste est au-devant de l’actualité et l’hashtag #metooinceste apparaît sur les réseaux sociaux. Cela a pu relancer divers débats à ce sujet, notamment sur le rallongement du délai de prescription ainsi que sur la sensibilisation des plus jeunes afin de lutter contre les violences intrafamiliales.
Pour autant, l’inceste n’a pas toujours été reconnu, la parole des victimes non-entendue. Il a fallu plusieurs décennies pour que la société actuelle permette de faire la lumière sur ce sujet. Soulignons que, même si l’inceste est principalement rapporté à une relation d’emprise de la part de l’individu d’autorité, l’inceste adelphique, ou fraternel, est peu discuté. Il peut sembler inconcevable, de par le statut de l’enfant ‟innocent”, que celui-ci puisse découvrir ses désirs sexuels et veuille les expérimenter auprès de ses collatéraux. Ce comportement sera catégorisé comme une perversion, une pathologie d’ordre psychiatrique. Or ce type d’inceste est rencontré de manière récurrente au sein des métiers du médico-social.
Cette initiation à la recherche s’appuiera sur des apports théoriques anthropologiques, sociologiques et psychanalytiques, ainsi que sur une étude de terrain effectuée auprès de différents professionnels du médico-social intervenant au plus près de ces situations. Ces apports permettront de dégager une problématique précise et de développer diverses hypothèses d’actions afin d’y répondre. Cet écrit soulignera l’importance du rôle de l’éducateur spécialisé, coordinateur du projet pour l’enfant.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=163&record=19412936124912301189
Parcours d'aidants, entre épreuve de réalité et bienveillance - MEIRE Allison
DEASS 2022
Titre :
Parcours d'aidants, entre épreuve de réalité et bienveillance
Mots-clés :
Personne âgée, proche aidant, épuisement, isolement, "aller vers", prévention
Résumé :
Qui sont les proches aidants ? Peut-être vous, votre conjoint, un autre membre de votre famille, ou un ami... De nos jours, l’espérance de vie augmente, les maladies neurodégénératives sont de plus en plus présentes. Elles bouleversent les histoires de vie, celle de la personne souffrante et celle de la famille. Les aides nécessaires peuvent être apportées par une multitude de personnes mais le plus souvent elles reposent sur une personne : le proche aidant. Son parcours de vie est alors coloré par la trajectoire de vie de son proche malade, au point que sa vie quotidienne en est imprégnée...
La posture de l’éducateur : un levier pour l’entrée en relation éducative sous contrainte ? SALLANDRE Coline
DEES 2022
Titre :
La posture de l’éducateur : un levier pour l’entrée en relation éducative sous contrainte ?
Mots clés :
Relation éducative / contrainte / posture / lien / rencontre
Résumé :
La relation éducative est le socle de notre prise en charge, mais elle n’est jamais donnée dès le début de l’accompagnement. Encore plus, dans le cadre d’intervention de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : l’aide contrainte.
Cette relation se construit au fil du temps et en fonction de l’éducateur et du jeune.
Si, au départ, j’ai souhaité questionner la relation éducative sous contrainte judiciaire, c’est parce que je me questionnais sans cesse : Comment j’établis une relation
avec un jeune qui n’a pas souhaité être ici ? Comment, avec ce que je suis, je peux faire basculer le jeune de la contrainte à l’adhésion ? Au fil de mes recherches, échanges et de ma construction professionnelle, j’ai avancé l’idée que la posture de l’éducateur influençait la relation éducative.
Cette relation éducative se construit au travers de moments quotidiens, de partage et de faire avec. Elle se construit au travers de l’engagement de l’éducateur dans celle-ci.
Ce mémoire vient questionner la posture du professionnel comme étant un levier à la relation éducative sous contrainte.
Pour consulter le document intégral : https://espacesantesocialhdf.fr/Record.htm?idlist=116&record=19408307124912265899